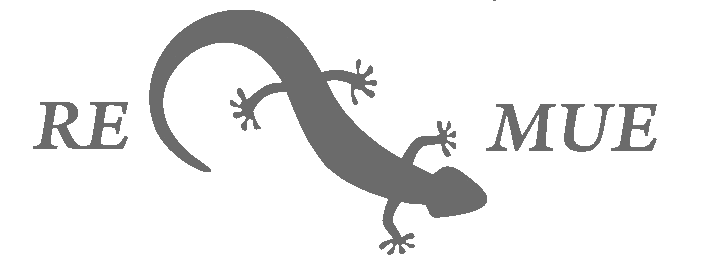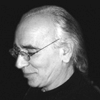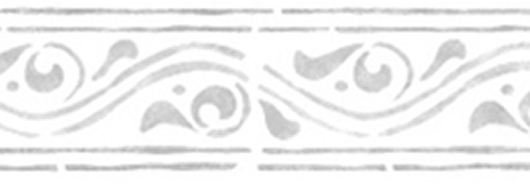![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue-
 |
RE-MUE revue littéraire des lézards en mutation permanente. Chaque mois, RE-MUE donne la parole à un nouvel invité |
N °6 |
Deux articles de Jean-Paul Gavard-Perret
MORSURES ET DECHIREMENTS - PERVERSION DE LA PERVERSION :
|
|
MORSURES ET DECHIREMENTS
Avec une artillerie à la Vidal-Naquet, feignant d’être indemne de toute idéologie, Omar Merzoug aurait eu toute sa place au moment de la naissance de la Quinzaine Littéraire plus que dans son numéro 2006. Il puise en effet dans les antiquités de la critique sartrienne un salmigondis d’idées reçues, de lieux communs les plus politiquement corrects de gauche. Puant la glauque et la charogne les arguments de l’auteur donnent le plus bel exemple du fascisme qu’il prétend combattre – oubliant au passage qu’il y eut dans le FLN d’aussi parfaits salauds que dans l’OAS . Se retrouve un découpage à la hache dans la mer gelée de l’histoire afin d’éviter toutes les contradictions qu’elle soulève sauf chez les sectaires qui ne doutent jamais de leur Vérité. D’un côté il y a donc les bons et de l’autre les méchants. Omar Merzoug multiplie les à peu près, les affirmations réductrices, méprisantes et méprisables. On se limitera à un simple exemple : l’auteur réduit le peuple européen d’Alger à « des petits blancs émeutiers en diable, antirépublicains, fascistes qui formeront les phalanges de l’OAS ». Seuls l’auteur et les aveugles osent croire à sa comédie humaine qui sépare le monde selon une division ethnique et manichéenne, essence même de tout fasciste. C’est faire de plus bien peu de cas des hommes en se concentrant sur une idéologie qui les limiterait selon leur appartenance de « couleur » à des vecteurs mécaniques d’une pensée unique : libérateurs d’un côté, exploiteurs de l’autre. Omar Merzoug a dû arrêter son histoire de l’Algérie en 1962. Camus a eu la chance de mourir avant cette date. Au passage cela est des plus arrangeants pour son procureur (sans doute républicain) de 2010. Quoi de mieux quant on est un dictateur qui s’ignore (donc des plus dangereux) que de commencer l’année par une exécution en règle ? Et on ne jouera pas au jeu des citations de Camus pour répondre aux insinuations vicieuses de son pourfendeur. Ce serait faire à ce dernier trop d’honneur. Et on s’étonne que la Quinzaine s’offre une idylle majeure avec un jugement aussi frustre que sommaire. Il est vrai que Maurice Nadeau a toujours été pour le moins circonspect (euphémisme…) par rapport à la vision Camus. Il est sans doute ravi que valet fasse le travail pour lui. Sans doute la gesticulation sarkozyenne autour du transfert de Camus au Panthéon plus encore que (l’excellent) « Dictionnaire Camusien » de J-Y Guérrin chez Robert-Laffont ont gêné Omar Merzoug. Il fut interpellé dans ses vertus inébranlables et sacro-saintes. La gangrène des nouveaux maîtres et oppresseurs de l’Algérie contemporaine l’indiffère sans doute. Soit dit en passant ils ne valent pas mieux que ceux d’avant 1962. Si ce n’est l’ethnie, pour reprendre une classification chère au polémiste, rien n’a changé sinon en pire. Mais il ne faut pas le dire trop fort au nom du politiquement correct dont Merzoug est devenu le pilier de bistro (sans alcool, accordons-lui ce bénéfice dans une bouffée de mansuétude). Sa mise en scène du parcours de Camus est digne du grand guignol et multiplie les mensonges. Chaque fois que les événements de la vie dérangent l’analyste (sic) il les tord non sans une forme de lâcheté intellectuelle. C’est d’autant plus facile que Camus n’est plus là pour se défendre. Quant au « réflexe tribal » dont il affuble Camus, le critique (resic) devrait d’abord se l’appliquer à lui-même. De fait Camus sort grandi de cette affabulation et de cet amas de gravats. Ce n’est le cas ni de Merzoug ni du journal qui colporte ses ragots, ses raccourcis, ces approximations. Sous le registre de la pure acrimonie, l’auteur monte un leurre, un diktat en oubliant consciencieusement de rappeler l’inconséquence de ceux qui au nom de la vérité se sont opposé à la splendide liberté et humanité camusienne. Cette décapitation de Camus fut un temps ludique : on pouvait s’en amuser sans prendre pour autant Sartre et quelques autres pour des génies de Djebels. Elle est beaucoup plus inquiétante aujourd’hui. Merzoug offre à la vindicte non Camus mais une image fantasmée de l’écrivain. Un tel spectacle au lieu de nous interroger nous abasourdit par ses songes creux. Croire effacer tous les problèmes des peuples opprimés en offrant Camus en pâture ne convaincra personne sinon l'auteur lui-même. Merzoug nous raconte sa propre histoire, son “il était une fois Camus” à coup de stéréotypes, de fiel et d’ une hystérie rhétorique. Certes Camus comme tout homme et tout écrivain connut des ratés, des ratages. Mais Merzoug ne les relève même pas. Il préfère montrer un Camus dont l’héroïsme se serait limité à celui d’un porteur d’eau. Soumis à une excitation libidinale haineuse, Merzoug devient le dindon de sa propre farce. Il feint de lécher Camus mais en cachant les dents qui le mordent pour le déchirer à qui mieux-mieux. C’est en ce sens qu’il fait comprendre le titre de son article. « Les déchirements d’Albert Camus » sont ceux qu’en bon chien de garde d’une idéologie dite progressiste Merzoug adresse aux mollets de l’auteur de « La Chute ». Quand lui-même sera capable d’écrire un tel livre nous en reparlerons. Le débat s’arrêtera donc définitivement ici. Jean-Paul Gavard-Perret.
PERVERSION DE LA PERVERSION :
Leonard Michaels, Sylvia, traduit de l’Anglais US par Céline Leroy, Christian Bourgois Editeur, Paris, 154 p., 17 E.. Les écrivains sont des affabulateurs. Sans mensonge la littérature ne serait qu’un songe. Mais c’est surtout lorsqu’il se pique de vérité qu’un auteur dépasse les bornes. En particulier lorsqu’il s’agit de son intimité. On sait depuis J.J. Rousseau que l’autofiction est le plus souvent un piège à gogos. Et s’il faut considérer les Confessions ou les Rêveries pour ce qu’elles sont à savoir des chefs-d’oeuvre ce n’est pas ce biais là qu’il faut les prendre. Pourtant Leonard Michaels nous refait le coup du jeu de la vérité. Il nous donne en pâture sa version de la relation passionnée qu’il vécut avec Sylvia Bloch de 1960 à 1964 c’est-à-dire lors de ses années de formation – à tous les sens du terme. Quatre ans d’amours insensées, pulsionnelles. Temps au-delà duquel, paraît-il, le ticket de la passion n’est plus valable. Si toutefois on en croit les chimistes de l’âme. Dans le cas qui nous intéresse ces années finissent tragiquement par le suicide de la femme. Cette mort rend son jeune époux et c’est lui qui l’affirme dans « Sylvia » « désespérément heureux »… Le livre devient un magnifique plaidoyer aussi poétique que pro domo. Il analyse rétrospectivement la tension et la proximité effrayante qui unirent deux êtres jusqu’à la désintégration. Selon Michaels elle fut plus profonde pour lui que pour celle qui y laissa tout de même sa vie… Certains doutes peuvent donc être émis. D’autant que l’auteur ne les lève pas tous. Charge donc à l’auteur non de s’expliquer. Il le pratique sous la traîtresse couverture de prétendre ne pas réinterpréter le temps passé. Voire… Car l’inconscient joue de splendide tours de passe-passe. L’écrivain élabore ce qu’il nomme des « mémoires en formes d‘histoires ». Mais le bât blesse. Sylvia devient dans son récit le « trou noir » de l’existence de la vie de l’auteur. L’épouse abusive se réduit à une sorte d’hystérique vociférante : « elle se repaissait de ses propres hurlements. Elle hurlait parce qu’elle hurlait toujours plus, toujours plus fort comme pour construire une petite cambre de rage au milieu de laquelle elle se tiendrait. Cet espace n’appartenait qu’à elle. C’était elle qui commandait. « Je n’y avais pas ma place » écrit Michaels. Et voilà : c’est plié ! Sylvia est réduite à des comportements irrationnels, obsessionnels. A un désir de possession absolu. Si l’on en croit (mais on a du mal à le suivre) le jeune auteur, il n’avait qu’à subir l’hystérésis de l’aimée. Il se contente de se replier prudemment et frileusement dans le silence. Il réserve la description des disputes et des cris de féminine engeance à un journal intime… L’argument est un peu mince. Mais Michaels a soin de ne rien dire de la façon perverse dont il se soumet à la prétendue hystérie de sa femme. Il feint – de manière confondante et innocente - d’oublier comment et combien le masochiste fait le jeu de sa prétendue sadique. L’auteur choisit la voie (et la voix) du silence sous prétexte de ne pas faire déborder ce qui excède la normalité. Il oublie de rappeler que cette prétendue normalité est pour lui une obsession, une addiction … Il feint de ne pas voir (mais sans doute ne le comprend-il pas complètement) comment sa stratégie du silence ne fait qu’entretenir et conforter l’excès. A la fois celui auquel feint de se soumettre. Et celui auquel il porte à ébullition celle qui n’a plus comme arme que le cri afin de réagir. L’épouse abusive est donc tout autant une femme abusée. Michaels jaillit aussi naïf que cynique dans un texte qui peut et doit se lire à l’inverse même de son ambition. On retrouve d’ailleurs dans « Conteurs, menteurs : une anthologie » chez le même éditeur d’autres textes de l’écrivain. Ils corroborent son attitude et sa stratégie existentielle d’auto défense. Au « délire » verbal de Sylvia répond chez l’auteur une écriture compulsionnelle, impulsive. Elle répond coup pour coup mais par la bande à la manière dont il s’est laissée (mal) aimer par Sylvia et plus généralement par les femmes embrayeuses d’agressivité. Ce qui d’ailleurs porte l’auteur dans une homosexualité larvée vers des amitiés masculines. La ou le pervers n’est donc pas celui qu’on croit. Michaels est pris dans son propre piège. Même et à son écriture défendant il est dévoilé. Ce maniaque de la normalité n’a cesse de se justifier. Et la propre injonction qu’il s’est donnée d’écrire n’est faite que pour ça. Mais heureusement il est une autre manière de lire les livres de l’auteur américain comme ceux de J.J. Rousseau. A faire l’impasse sur l’ambition à l’auto justification qui frise parfois jusqu’à l’indécence l’auto complaisance se découvre soudain une puissance formelle aussi obsessionnelle que désarmante. Il arrive que le texte échappe à son auteur et à son souci premier. Loin de la justification l’écriture soudain ne se pense pas, ne se pense plus. Dans « Sylvia » les mots sont tissés, sculptés, construits de mille matières et c’est leur poids, leurs rugosités, leurs contractions qui font tout leur sens et transforment le vacarme de « l’héroïne » tragique en silence Sortant de la préméditation un tel livre confirme la phrase de Duras dans son dernier livre « Si on savait ce qu’on va écrire on n’écrirait pas ». Tel est donc le paradoxe des grands livres : par un exercice journalier et attentif « d’imbécillité » (Novarina) ils deviennent des livres qui dépassent leur auteur. Ils acquièrent même le statut de chef d’œuvres. « Sylvia » en est un. Paix à l’âme et au corps de son instigatrice. Même si elle méritait mieux que ce tombeau pourtant parfait dans son marbre.
Jean-Paul Gavard-Perret.
|
![]()