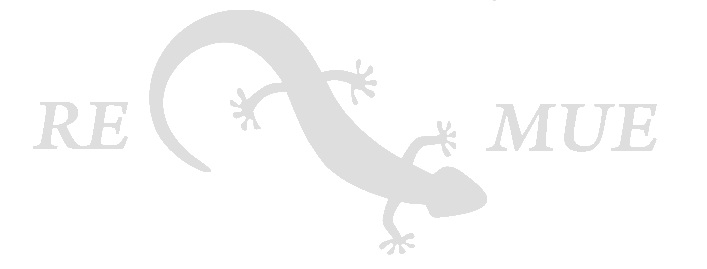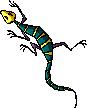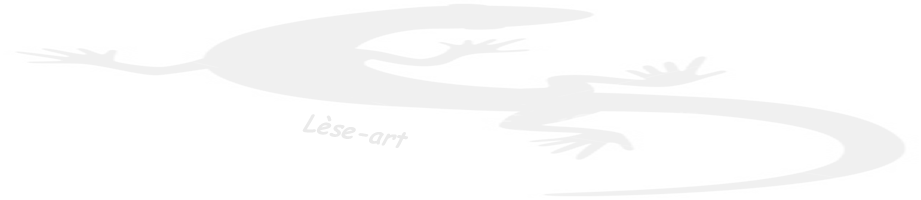ELOGE-DE -LA -BANDE -DESSINEE-SUITE -AU
« PACTE --BICEPHALE »
Paul Sanda, « Sept Fragments, immanents pour une Alchimie Poétique »,
Editions Rafael de Surtis, Cordes sur Ciel, 2012.
Paul Sanda continue à expliquer comment les images de l’enfance « ont pu être à l’initiale de tout processus inconscient de transformation et ont ainsi pu servir de déclencheur » à toute son œuvre et d’avènement à son « éclosion spirituelle ». C’est de là en effet qu’est parti tout un travail de lâcher prise. Il a conduit le poète où il est parvenu aujourd’hui. L’artiste fait donc retour sur des images premières : Sylvain et Sylvette, Petzi, Tintin, Kybriz Toulbasar, Mirko le Petit Duc, les héros de la Planète Bouboule et Le Moine façon Hugo Pratt. Plus particulièrement certaines vignettes ou fragments de ces œuvres d’infra-littérature ont ouvert le futur auteur à l’apprentissage de valeurs aussi hautes que l’amour. Mais pas n’importe lequel : « celui qui se donne et ne se reprend pas, celui qui nous échappe, nous dépasse, le simple fils du soleil, de la véritable lumière ».
De telles œuvres ont poussé le poète vers un surréaliste transactionnel qui ne se contente pas des vénérations envers les maîtres historiques de cette école. Petzi et son vélo sans frein fut pour Sanda le modèle de celui qui aura osé l’exploration intérieure au risque même de la folie afin de chercher le grand mystère. Il en va de même pour un Tintin. Ce dernier par sa non-origine même ouvre la béance. Sans parents et sans maîtres il se fait lui-même. Ces œuvres premières furent autant de creusets pour celui qui comprit à travers elles que la seule règle de la création consiste à « perdre le fi ». Sanda apprit qu’on ne doit jamais effectuer la poésie que l’on veut mais celle que l’on peut.
Trop d’œuvres sont intelligentes, ignorent l’obscur travail de l’instinct et de la sensibilité. Ce qui ne veut pas dire qu’une maîtrise et une connaissance soient inutiles. Néanmoins le vrai apprentissage s'effectue à travers des œuvres considérées comme mineures mais qui ne le sont pas. Bien au contraire. Elles permettent au créateur de ne jamais tomber dans des poncifs ou des évidences. Elles enseignent comment désapprendre l’intelligence par un long et lent travail « d’imbécillité » sans laquelle l’art et la poésie ne sont rien. Devant le monde inacceptable tout poète se doit de le ré-inventer comme surent le réinventer – presque sans le savoir – Hergé, Claude Dubois, J. Lebert, Antonio de Vita. Ils ont senti comme Sanda plus tard qu’ils devaient avancer obscurément vers sinon « La » forme du moins ses exigences et ses possibilités.
Trop d’artistes s’y dérobent. Devant cette tâche immense ils décrochent, trichent, tombent dans la facilité en acceptant des solutions de rechange et dans le goût du temps. Par leur humilité et à l’inverse, les vrais démiurges n’ont pas dérogé à leur tâche. Sans doute parce qu’ils ne cherchaient pas à suivre un certain bon goût et parce que leur ambition n’était pas teintée d’ego. Leurs œuvres n’ont donc jamais capoté dans le pastiche. Contrairement à des créateurs bien en cours, ils n’ont pas quémandé les honneurs et ne se sont pas excités de simulacres. Ils n’ont jamais croupi dans de l’à peu près, des déclinaisons. La démesure, la folie furent à l’œuvre dans leur œuvre loin des exhibitions feintes.
En cela ils ont transformé la sensibilité de Sanda.
Il découvrit chez eux un lyrisme particulier et une sorte de surréalisme visant à exhiber du monstre. A travers eux il a compris que chaque artiste pour devenir assassin de l’art doit se mouiller les mains. Il ne peut éviter la confrontation avec qui il est et ce qu’il peut donner. Et si dans toutes formes d’art les manières de tricher sont nombreuses, de tels créateurs ont torturé des formes pour les sentir exister. Ils ont appris au créateur combien la poésie est indomptable. La piétiner comme on piétinerait un réveille-matin ou un quelconque objet pour le mettre en pièce ne change rien au monde des formes poétiques. Le créateur qui se contente d‘un tel geste faussement iconoclaste se trompe de cible car l’objet reste extérieur à lui.
C’est donc bien plus dans la confrontation avec la règle du jeu que l’artiste conséquent fait appel à des moyens d’attaque. Sans cela l’art comme l’artiste restent inchangés de leur confrontation larvaire. Les auteurs dits mineurs des B.D. citées l’enseigne. Ils ne pouvaient se contenter d’être les révoltés à deux balles qui prétendent se venger d’un monde qu’ils estimaient fermé. Ils sont passés loin des iconoclasties de façade. Mais comme tels ces anarchistes ont été mis sous le boisseau.
Il existe plus d’originalité chez eux que chez des artistes officiels. Ces derniers se révèlent de simples « décorateurs » du temps encensés par les modes. Les premiers ont donné forme à un univers qui était à la fois en eux et hors d’eux. Ce qu’ils ont montré était - et sans savoir pourquoi au juste - le prolongement extérieur visible de leur lutte. En cela ils nous bouleversent et il bouleverse l’ordre établi comme ils ont ébranlé Sanda.
Chaque fois ils remettent tout en question. Lorsque Hansen ou Pratt inclinent une ligne toute l’organisation du monde bascule. Ils donnent en conséquence une nouvelle chance à la vie à l’inverse d’un Damien Hirst ou d’un Jim Dine. L’art des premiers comme la poésie de Sanda sont intéressants parce qu’ils demeurent proches du poids confus de sensations et d’une charge de formes (exubérantes ou proches de l’extinction) mal démêlées, sources d’angoisse et de plaisir. De telles oeuvres connaissent aussi toute la masse de réalité qui pèse sur elles de toute part. Elles restent donc une façon de se confronter au monstre et demeurent chargées de réel.
Sanda prouve qu’elles ne sont ni objets, ni reliques. Elles restent - dans leur brutalité loin de toute ambition « artistique » - perméables à la sensibilité comme à l’intelligence. Bref elles perdent la raison. Et c’est là l’essentiel. Il s’agit toujours en poésie comme en art d’échapper par les sens au sens pour le faire dévier. Les « Sept Fragments » resteront comme un des plus vibrants hommages qu’on peut écrire sur des images si souvent oubliées ou vilipendées et qui tendent pourtant comme l’écrit le poète « à une nouvelle immensité »..
J-Paul Gavard-Perret
TARIK --ESSALHI : LES -BENEFICES -DU- PIRE.
Tarik Essalhi montre dans la douleur ce qui lui faut pour être mais pas plus. Il ne lui fait jamais trop honneur. Il la présente mais sait qu’il ne faut pas seulement souffrir pour exister sinon à croire à l’éternité. Il sait aussi qu’on est hors de toujours et de jamais. Il faut en rester là. Par la patience de la patience. Otages nous sommes. Mais otages irremplaçables, dans la passivité au nom d’un événement non du passé mais immémorial. Vécu dans le présent comme revenant.
D’une certaine manière par ses dessins et sculptures l’artiste déterre les victimes, parle leur silence dans des cérémonies délétères mais puissantes. Le non-être n’a pas à se venger c’est en nous qu’il médite. Car Tarik Essalhi le fait exister. Ce n’est pas vague mais précis. Rien comme eux, comme les fragments de leur corps pour s’insérer où la vie même si elle semble encore sans promesse. Le suspendu ne descend jamais, le couché ne se relève plus. La possibilité n’est pas possible : elle est ce qui n’a pas de fruit.
Le créateur rappelle que nous jaillissons tous du gisant. Ou si l’on préfère du gisement premier, point explosif du principe du néant et de l’infini de son fondement. Nous sommes que matière. Même si pour les croyants l’esprit serait la résistance de l’inexistant. Manière d’oublier que nous sortons de maman et de papa. Néant ils furent, néant nous sommes. C’est pourquoi Jésus n’est qu’anecdote. Même sublime il n’est que né enfoncé. Les choses se font ainsi. .
Tous les personnages de Tarik Essali portent des stigmates. Personne ne peut s’en tirer en vie. Cela prouve la grandeur de l’art et la faiblesse des croyances. L’art est le crime contre celles-ci et pour l’intelligence. L’art est un crime magnétique, électrique, atomique afin de transcender la misère corporelle de l’humanité et lui donner l’impression de tenir encore dans sa condition lapidaire.
Toutes ces œuvres prouvent que la schlague est le critère des lois religieuses et/ou politiques. Il s’agit d’assurer la puissance de quelques-uns sur tous au nom d’une solidarité humaine. Tout fonctionne pour le plaisir de certains. Leur volupté tient à l’imbécillisation du plus grand nombre. C’est vieux comme le monde. La prétendue progression de l’humanité est l’arrangement subtil du système capable de faire prendre les vessies pour les lanternes.
L’artiste nous fait comprendre les erreurs conformes qui nous clouent. Reste toujours des holocaustes et des anéantissements du midi. Cela s’appelle l’histoire de l’humanité que l’art se doit de dénoncer par des images fortes de la persécution. Il y a quelque chose de troublant à voir des personnages ainsi exposés et comme livrés à la viorne de bourreaux hors-champs. Les premiers sont comme après la mort perpétuelle que Tarik Essalhi met en scène. Oui ils sont exposés au mourir.
D’où la fraternité qu’il suscite. Nous les aimons mais nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils sont déjà tombés dans le désoeuvrement. Nous les observons, c’est eux qui veillent. Ils nous demandent plus d’attention que nous ne leur en accorderons jamais.
Composant avec les forces subies et les aspirations sans réponse l’œuvre est une ascèse. L’être est recomposé avec ombre et lumière. Sans la distraction d’exister avec un dieu. Plus tragique encore : la figure d’autrui en qualité de « prochain » est compromise. Dieu lui-même n’est qu’un emplâtre sur une jambe de bois, une invention humaine, une machinerie cruelle d’asservissement. Il est à lui-même la colonne pénitentiaire érigée par les hommes et soulignée par Kafka.
Le destin des personnages ainsi réduit parfois au rang de fantôme sous linceul est l’aspect de la chute de chaque être. L’être n’émerge de son absence qu’en se refusant à son existence charnelle. Non par choix mais parce qu’on ne soumet de la sorte.
.
Restent des traînées de sang par l’emprise paradoxale de blanc des statues ou le graphite des dessins. Les êtres n’en sont que plus froids, plus rigides dans des postures qui rappellent parfois celles de la torture. Reste ce dialogue abyssal d’une liberté inquiète. De la responsabilité aussi. Les êtres sont sans pouvoir, la terre souffre. Mais pourtant Tarik Essalhi veut croire à un sens. Son oeuvre reste le signe qui survit en attendant que l’action crée un chemin d’existence. Pas à pas, pied à pied, attendre qu'une porte s'ouvre. Même si le doute perdure.
J-Paul Gavard-Perret