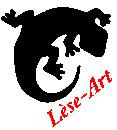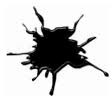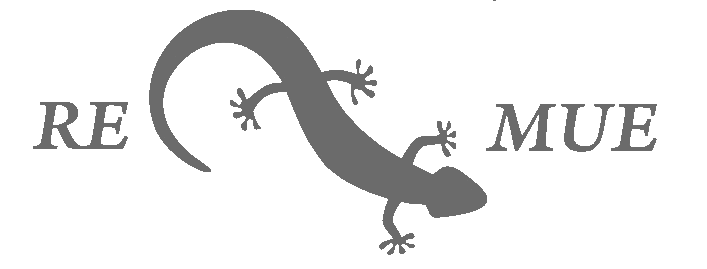Extrait de « La glaneuse »
À l’heure vide, une histoire bégaie en elle ses profonds murmures. Des choses simples venues du silence, soutenues par de fragiles respirations dans la lueur d’une pensée discrète. Un toussotement. Un halètement. Des feuilles mortes se préparent à errer. Un sourire. Une jeune fille qui passe. Un regard qui se joue des confidences. Une lumière paresseuse qui décline et la tentation de faire rougir le diable. La foule aux terrasses. De l’agitation en ville et la vie qui tente une trêve. Elle, assise, elle ne porte rien ni en elle ni sur elle. Seul, le sentiment de garder quelques souvenirs au bord de ce qui attend et qui, peut être, est déjà sclérosé. Elle pense que le rêve est encore permis. Que flâner, lui procure des moments de répit, de liberté, de se soustraire à tout. Ce sentiment de n’être dans rien, au bord du monde, au sein d’une résistance farouche à l’ordinaire, prête à bondir comme un dernier sursaut face à l’enlisement.
Elle se demandait comment rendre aux choses simples leur beauté ? Est-il possible de rendre l’humanité à sa beauté, à sa grandeur aussi généreuse et humble dans cette idée meilleure de l’humain ?
Que pouvait-elle ? Sinon se taire et voir le sable filer dans le cristal d’un regard. Dans le désespoir d’une étoile filante qui doute de sa trajectoire. Tout lui semblait nu, douteusement étrange, passablement incongru, étrangement douteux. Persévérer à bégayer les mots qu’il faut, brûler au feu glacé d’une résistance face à l’évidence fade. Accomplir la longue traversée du néant. Seules, quelques graines de sable, quelques pierres, quelques déserts, quelques horizons néfastes.
« J’emporte mon ciel dans le lait de mes seins. Je prends place parmi ses blessures. Je prends tout ce qui me permet de rêver dans mon regard, au fond des yeux de mes yeux. C’est pendant ce voyage que j’ai appris à boire du vin en cachette, pour dissiper ma peur à moi-même et aux autres. Je l’avais mélangé avec de l’eau.
Je vais mourir quelques années plus tard parmi youyous et colères. Un monde en moi s’éveille et un autre s’endort. Je porte en mon corps ma liberté. En mon dedans, mon secret, comme une promesse qui vient des origines abyssales. Je ne mesure pas mes pas, je marche maternelle au rythme de l’univers. Je marche insolite, choquante, bruyante, amoureuse, rêveuse. C’est ainsi que j’ai le sentiment de renouer avec la vie.
Je laisse la chair de ma chair, la lumière de mes lumières, mes odeurs, mes senteurs, ma sexualité, je laisse mes peurs, les pucelles de mes yeux, les berceuses de mon enfance. J’ai peur. Je pars vers la mort. Je laisse les mots de ma mère, orphelins de confidences. Quand j’étais enfant, mon père disait que j’étais rêveuse d’un océan de sable sans lendemain.
Je laisse mes silences au gré du vent. Je laisse la mer que je traverse et ses sillons au hasard des amours. Ni le ciel ni la terre ne s’achèvent avec l’horizon. Je laisse une blessure où le monde baigne sa chevelure parce que l’exil s’est glissé dans mes yeux. Les oiseaux sont légers et le vent s’embourbe parmi les pierres ».
Elle est là pour attendre un peu moins d’épaisseur de ces si grands et si petits secrets, sans prétention aucune. Elle est là pour étreindre ce qui l’a précédé dans la douleur et le désir. Elle pourrait penser que la vie est un hasard qu’on ramasse au bord d’une quelconque évidence. Elle avait le cœur triste. Elle avait la vie soudaine et brûlante dans l’éclat des vagues colportées par le vent. D’elle à elle, jour après jour, elle soude la mort à la mort. Survie sans demeure ni chemin, née, déchiquetée dans une longue marche vers le néant. Elle a besoin de se mettre en mouvement pour traquer la peur, sans relâche. Que lui importe la marche, la fuite, la respiration, le temps, l’élan, l’oubli, la raison.
Elle pense que tout est là. Elle dépose son visage auprès du ciel, ses mains au ventre pour sceller une crainte à une autre. Détentrice du sel dans la vague d’une tendresse, elle joue ses pommettes et gonfle son cri hasardeux. Rien n’est visible. L’incessante obligation de réapprendre à vivre, à inciser le temps, pierre par pierre. Elle la bouscule, la harcèle, et tandis que sa voix baptise la douleur, elle disparaît dans la houle d’un naufrage. Elle glisse dans le sourire d’une rébellion.
Tout se confie, chaotique, précis, inlassable, précis. Tout se noie, se tend, demeure une inexplicable splendeur et mouvante douleur.
Elle part nue. Ses cheveux admettent la confusion des choses. Elle entend, comprend. Elle habite les orages. Sa chair habite la houle des vagues. Elle porte le vertige dans ses mains ivres. Plus haut, plus loin, ses yeux habitent l’épaisseur du vent. Elle jouira sans retenue. Elle surprendra les sinistres angoisses des matins. Tout lui sera un monde nouveau. Elle délaissera les courbes humides des nuits précédentes. Elle portera sans peur l’argile de son ventre vers des marées lointaines.
Elle se souvient des grandes ruines. De l’infirmité des hommes, elle connaît les grandes peurs.
Voilà pourquoi si d’aventure elle livre la nudité de ses seins aux digues de la nuit, elle arrache les hommes à leurs ombres.
« Où commence mon visage dans le vent ? Où se niche mon chemin conduit à travers frontières et roulis de train, entre murs dressés et montagnes étendues qui se passent d’horizon. Cloisons, murmures, interdits, jours clos, lointain en berne, sourdes batailles, métaux dressés, l’ordre à suivre, drapeaux en dérision, l’usure du temps, hautes destinées pour les hommes.
Je me tiens nue, face au vent dans les ruines interdites à mes semblables, dans l’oblique de la colère sous la vibrante passion de vivre. Mon rêve a pour haillon le silence de la nuit des villes.
Je me tiens au fond d’une brèche sous le porche de la peur, dans mes pauvres mains l’éclat de quelque chose qui se tait. De part en part, mon voyage est une attente qui s’empare du jour dans le fracas lent de chaque lieu, de chaque pierre, de chaque sol. Jusqu’aux racines, à l’épuisement, ma colère disperse le bruit muré d’un espoir en quête d’élan.
Je me tiens dans l’effilé. Dans l’épars. Dans le rompre. Dans l’ exister. Dans le veillé. Dans le pourchassé. Dans le ravivé. Dans le deviné. Dans la rature. Qu’est-ce que mourir et qu’est-ce que vivre ? ».
« Dans les secrets des arcs en ciel un cerf-volant, naviguant dans les murmures de mes désirs. Des femmes en train de planter des silences en haut de la colline. Les oiseaux au loin semblent s’envoler dans la barque des nomades vendeurs de vent. Sur la plage, à marée basse, les amours des mouettes pêchent les soupirs de quelques crabes retardataires. Un jeune chien aboie vers les grenouilles et revient bredouille auprès des papillons. Sur les ailes de quelques enfants criards, le ciel pose ses petits pour le repas de midi.
Toute fourbues, mes pensées vieillissent auprès du temps, leurs pétales cousus dans des cheveux blancs. Quand ma bouche grimaçante peine à épeler mes amours, les cerises de ma douleur s’égouttent dans la boue de mes faiblesses.
Dans l’eau, les difficiles noms des adieux semblent s’amarrer aux joues des hommes.
Je bourgeonne jusqu'à mon ombre, pleine de matin pour y n'être un enfant. Contre le vent, je suis invisible, tardive, éparse, ondulante. Pas d’autres bruits que la présence des papillons. »
« Je franchis le monde houleux, tout bruit, avec le ressac rocheux des vagues et les cris des mouettes. Avec le sable qui file, boudeur, et le murmure du vent prétentieux. Avec les montagnes fiévreuses et les pluies en averse. Avec les champs ensoleillés de maïs et les attroupements de chiens de garde.
En marche vers le tout monde, dans mes étreintes, le monde alentour. Dans mon souffle les douceurs tièdes de toute attente.
Ailleurs et partout, j’ai fait des haltes aux barbelés du temps, à mes seins, tous ceux qui ont soif et faim. Je marche vers le monde, toute froissée. Toute en colère. Je ne crois ni en dieu, ni en l’homme, ni aux prophètes, ni aux révélations. Je ne m’attarde pas, je marche toute pauvre, ne possédant rien. Déshéritée. Répudiée. Rejetée. Refoulée. Violentée. Sans nom. Sans filiation. Dans le doute. Dans la peur. Dans la marge. Dans l’écart. Je marche toute blessure confondue vers une liberté sauvage, rongeuse de mythes et de légendes.
S’il est nécessaire, je m’exilerai encore, de part en part, de cap en cap, je ne me soumettrai pas aux yeux glauques de l’humanité. J’ai de quoi séduire.
Dans la charpente houleuse de l’amour scintille sur mes lèvres la demeure de mon naufrage ».
Tarek Essaker
![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue-