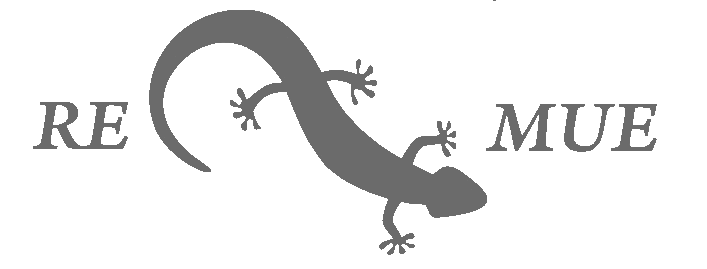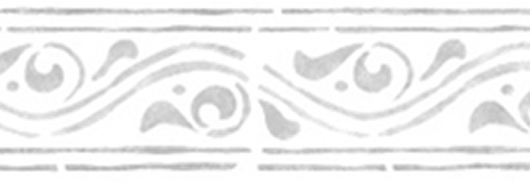![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue-
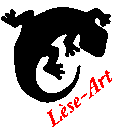 |
Deux articles de Jean-Paul Gavard-Perret |
N °11 |
« Les cavales de Nathalie Quintane » et « Sculptures sonores : le ventre de l’architecture. »
|
|
LES CAVALES DE NATHALIE QUINTANE :
Nathalie Quintane est habituée des cavales. Pour preuve ce mot est devenu le titre d’un de ses livres. Mais dans « Cavale » le mot lui-même est pris à revers. Il ne s'agit pas de proposer des périples pseudo autobiographiques à la road-movie littéraire où une « déviante » raconterait ses dérives plus ou moins romancées dans une mouvance du type Cathy Acker. Ici la cavale est plus profonde et plus abstraite. Elle appartient aux mondes des idées d'un narrateur affolé (oncle assassin déguisé en quilleur) dans une errance à la fois géographique de la Picardie à la Californie - le road-movie devient donc transcontinental - et "historique" puisque les temps se mêlent. Ce roman reste sans doute un livre majeur de l’auteur. Il fait le point sur son œuvre passée et synthétise dix livres et dix ans d'écriture. Plusieurs passages représentent des références à d'autres textes plus anciens de l'auteur quant à sa langue. C’est d’ailleurs une constante dans l’œuvre qui cultive paer qailleurs de fausses tautologies. Une phrase tel que «Quand la voiture roule à cent à l'heure, je roule à cent à l'heure, quand le moteur a serré, j'ai serré» se retrouve une typologie formelle qui est chère à l'auteur. De Jeanne Achète on passe par exemple à Jeanne d'Arc dans des systèmes de faux raccords. Et pour en ajouter une couche la première partie de "Cavale" est composée de 21 "débuts"… Leur point de départ représente ce qui a toujours intéressé l'écrivain : comment, à partir de l'écriture décoller vers l'ordre du romanesque picaresque en transgressant les textes antérieurs. Dans "Antonia Bellivetti" (POL, 2004) l’écrivaine révélait déjà le même type de questionnement et une espèce d'entre-deux entre la volonté d'écrire un roman pour la jeunesse et le résultat final qui marquait une sorte d'échec de l'objectif premier. Ce livre était selon l’auteure « une série de textes courts qui faisait le pont entre ses textes et livres précédent et le roman à proprement parler ». Avec "Cavale" le saut était fait. L'aventure est au rendez-vous même si le roman dans son essence est quelque peu différé (quoiqu'on ne le perçoive pas ainsi) puisque suivant la « romancière » elle-même on ne passe pas vraiment à la fiction : "la porte est toujours battante" dit-elle. Il s’agit donc d'un roman, mais comme toujours chez Quintane d’un roman raté. Comme est raté l’un des plus grands romans de tous les temps « L’Amérique » de Franz Kafka. Celui-ci aura laissé lui aussi la porte battante jusqu’à son héros dont les noms oscilleront selon les avatars et les versions laissées en plan pour que le jeu de courant d’air reste magistral dans un registre du fermé-ouvert. Nathalie Quintane cultive cette même veine. La digression est toujours. Elle devient même une nécessité narrative comme si le roman lui-même était une dérive à laquelle l'auteur ne peut donner de sens. La fiction reste un pont suspendu au-dessus du vide et dénué de tout parapet. A l'image de son narrateur de « Cavale » l'auteur perd la boussole, elle est saisit de vertige. Et c'est tant mieux. "Je ne fais pas de plan, même si ponctuellement il peut y avoir programmation. Une partie par exemple peut être "programmée" par un énoncé logique : ça ET ça OU ça mais PAS ça" précise l'auteur dans un entretien avec Florine Leplâtre ( in revue Inventaire-Invention en 2005). Cette critique note d'ailleurs avec justesse que le roman quintanien est extrêmement dense avec tous ses sauts dans l'espace et dans le temps. Le saut et la gambade sont en effet une particularité de l'écriture de l’écrivaine comme nous avons déjà pu le souligner. Saut temporel et/ou gambade spatiale : ce qui compte ce sont les disjonctions et les bifurcations. On est donc bien là dans le registre du picaresque dont l'auteure est friande. "Jacques le Fataliste" est un roman qui la fascine car Diderot joue avec le statut du narrateur, passe d'un sujet à l'autre. D'où son goût aussi pour Don Quichotte , Tristram Shandy , ou encore Machado de Assis. Se découvre chez ce dernie le mécanisme du « grand ensemble » (2008, POL) de Nathalie Quintane. Un fantôme la hante (La guerre d’Algérie) . Et l’écrivaine reste insatisfaite de sa commémoration qui le célébra pour mieux l’effacer encore. « À la suite d’un herpès occurré à la lèvre supérieure en février deux mille trois et particulièrement défigurant, je décidai d’écrire un texte intitulé L’Année de l’Algérie » écrit-elle mais c’est bien son livre de 2008 qui donne un corps à ce spectre. Et si en 2003 « J’étais donc en partance pour Genève en Suisse, si bien que parvenue j’allai me présenter au bord du lac Léman sans linge mouillé plaqué sur la face (de vierge éplorée bouche ouverte de ne pouvoir respirer), élégante sculpture plissée de blanc sur fond blanc tirée de LE PETIT SOLDAT, Jean-Luc Godard, Rolle, 1960. La vierge éplorée craint l’eau froide. C’est qu’elle a perdu son petit garçon. Nous savons à présent évoquer une torture sans passer par l’oxymoron », en 2008 l’auteure y interroge sans relâche sa mémoire personnelle. Mais plus que ses souvenirs elle questionne ceux de la génération d’avant des fomenteurs de guerre. Elle tente de venir à bout des phrases fameuses :« On utilisera tous les moyens », « On ne mettra pas les gants », etc. Ces phrases que les vrais et faux démocraties de tout pays s’autorisent parfois sans complexe. Elle laisse enfin à nu la légèreté avec laquelle un pays tout entier met en scène son passé pour le cacher comme une fille pudique fait de ses dessous. Les approches formelles, les angles, les tons, les registres se multiplient, se croisent et se répondent. Mais l'auteur possède d'autres influences plus surprenantes. Par exemple un vieux groupe de rock expérimental, "United States of America" qui a sorti un album rare écrit par Joe Byrd ( élève de La Monte Young et de Terry Riley) où il revisite toute l'histoire du rock et l'histoire des États-Unis. Voici ce que Nathalie Quintane en dit : "Il y a des morceaux, des plages très longues, de six, sept minutes où il passe d'un genre à l'autre; ce ne sont même pas des glissements, il y a vraiment des ruptures de ton : c'est le type de travail qui continue à m'intéresser et à me fasciner". C'est pourquoi l'auteure possède elle aussi le goût de l'ellipse qui dit-elle est "tellement énorme que c'est une crevasse, c'est la fosse des Mariannes". Cette ellipse souligne d'ailleurs la stratégie fictionnelle à l’œuvre dans l’œuvre : la fuite des idées, la confusion mentale. Les deux sont la résultante d'une mécanique romanesque très précise. Travaillant que sur le motif (le motif étant la langue) Nathalie Quintane avance par à-coups. Pourtant le résultat demeure quelque chose de très construit, même si l'ensemble est sinueux. Les amorces viennent des mots eux-mêmes : « c'est du hasard manœuvré, de la cuisine fabriquée à partir de rencontres de hasard, de télescopages » écrit l'auteure. En multipliant les sauts entre les registres, les idiolectes, les dialectes et les anglicismes le but n'est pas de rechercher un effet ludique mais de découvrir « sur le tas » une anti-rhétorique. Celle-ci devient le moyen de détourner le ronron littéraire ambiant et ses histoires à la con. Nathalie Quintane résume bien sa poétique au sein l'interview accordée à Florine Leplâtre : « dans un texte il y a toujours une dimension politique, sinon ce n'est pas intéressant, enfin, ça n'a pas d'acuité». Elle voue pour cela une admiration à H. Cadiot. Il infléchit la politique d'un côté beaucoup plus ironique que militant avec une espèce de plaisir obscène pour pendre les politiciens à leurs mots à maux. Et l'idée de "pirater" la rhétorique actuelle pour essayer de la détourner et d'en faire une arme reste ce qui domine le plus souvent chez l’écrivaine. Elle « se convertit tout en texte. Y compris un schéma analytico-intuitif traitant des conditions de possibilité d’énonciation de la phrase :j’amène des cornes de gazelle à la patronne ». Et « Contexte jamais superflu » ajoute-t-elle (Grand Ensemble, p. 16). Dans "Cavale" comme dans ce texte il en est question jusque dans la manière d'écorcher volontairement les mots de mettre tout cul par-dessus tête. Un militaire se fait blâmer pour avoir écrit «de Galle» au lieu de «de Gaulle » comme si celui qui a le pouvoir venait rétablir le nom correct, rappelant qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas, des choses sacrées. A la manière de Beuys dans l'art, l'auteur s'élève dans sa littérature contre les figures politiques mythiques qui mettent en scène quelque chose de l'ordre du fétiche. Cela l'insupporte. Et l’artiste de préciser : « c'est permanent, en particulier depuis le romantisme, cette reprise en main ; ça évite de lire les textes, de dire que Rimbaud est un poète maudit qui a fini sa vie trafiquant d'armes je ne sais pas où, ça évite de se pencher réellement sur ce qu'il a fait, qui est moins "excitant" que ça quand même, ou excitant autrement, pas pour ces raisons-là ». Toute l’œuvre de l’auteur demeure cependant moins le récit d'une cavale que de son "empêchement » par des discours déviants de personnages ou de figurines. Mais de telles digressions donnent des pistes qui vont dans un sens plus important que l'évènementiel. A propos du moine dominicain qui se masturbe à sa table de travail, l'auteur écrit «c'est à celui qui sera le plus littéral». Mais il ne faut pas voir ici simplement une allusion au ridicule de l'exégèse chrétienne voire un discours sur la vanité de l'interprétation des textes. Un tel passage est l'occasion d'arriver à cette question de la substance, et de l'essence, et de les traiter « de manière très, on va dire, enculatoire » dit l'auteur... Mais il est deux autres questions qui animent l’œuvre. Celle du passage à l'action et de ce qu’il en est d'écrire. Nathalie Quintane précise : « Il y a cette idée qui est entrée dans les mœurs: écrire, c'est un acte, l'écriture est performative, ça agit, dire c'est faire; on est dans cette sphère là de pensée pragmatique, on est tellement dedans qu'elle n'est pas discutée ». Pour sa part et si elle est arrivée avec ses bagages culturels dans l'écriture elle ne veut pas en sortir avec les mêmes : d'où sa "cavale", sa "fuite" ce qui ne veut pas dire que l'écrivaine rejette tout en bloc. « Je constate depuis quelques années que les lectures psychanalytiques sont devenues complètement caduques. Les gens plus jeunes ne lisent plus ça, pensent que ce n'est pas bien, que c'est réactionnaire ». L’auteur juge cette attitude absurde et s’inscrit en faux contre une idéologie molle masturbée par une philosophe poujadiste en 2010. A l’inverse pour Nathalie Quintane il ne faut pas se fermer certaines les portes pour être bien dans la ligne du temps. « Il faut que ça déborde aussi, et de fait ça déborde. J'essaie de tenir compte du fait que ça déborde » écrit-elle . Et si l’œuvre part en cavale, ne s’occupe que de ça, ses textes travaillent en profondeur ce "ça", cet inconscient qui n’est rien qu'une surface à trouer où se cache encore plus d'obscurité qu'on pouvait (Freud et Lacan compris) le penser. L’œuvre de Quintane est donc vivifiante, remontante sous sa déstructuration. Elle soulève quelques problèmes fondamentaux auxquels l'auteur ne donne pas forcément de réponses. Si ses premiers textes marquaient une position fixe, les plus récents en esquissent une plus dissolvante. Construite par plaques l’œuvre est faite pour la dérive loin des autosatisfactions de l'autofiction où tout auteur nombriliste parle de son cadavre à heures dites et redites. A l’inverse la créatrice se distingue par défaut de la production ambiante. Chargée de mettre en branle courts-circuits et digressions elle refuse avec humour toute cristallisation des procédés de style. Chaque livre d continue ainsi à travailler contre le précédant même s'ils sont tous armés de la même langue. Et Quintane de déclarer : « la poésie, c'est pas comme le hard rock, c'est pas un truc de jeunesse. C'est ce qui permet d'amener à l'acte ce qui n'est sinon qu'une activité de plus, c'est-à-dire que c'est ce qui donne des armes pour briser le statu quo - un opérateur, si on veut ». Caque texte de l’auteure est donc bien un opéra, une opération : à savoir une ouverture qui met à mal jusqu'au lexique des genres. L'auteur donne l'exemple parfait de la littérature du décalage, pas étonnant dès lors qu'elle voue une admiration aux irréguliers de la langue, tels que Arthur Cravan hier ou Valère Novarina aujourd'hui. Bref de tous ceux qui posent l'écriture au sein d'un "arrangement" plus large, qui la comprennent « dans et par ce qui est incertain ». C'est avec ce désir et cette intention que la littérature reste une mécanique en marche donc vivante.
SCULPTURE SONORES :LE VENTRE DE L’ARCHITECTURE
Eric La Casa / Jean Luc Guionnet, « Reflected Waves » (Ondes Réfléchies), Trace(s), Passage d’Encres, Romainvile.
Répondre à un timbre par un autre qui n’est pas forcément sonore tel est l’enjeu pluridisciplinaire de La Casa et Guionnet avec « Reflected Waves » et « Installation ». Les deux artistes dont la pratique est pourtant bien différente même si les deux s’intéressent aux strates musicales ont développé (suite à une commande de Philip Samartzis, directeur de festival Liquid Architecture de Melbourne) une pratique artistique multiple. Elle permet d’aborder le problème des interactions d’un art à un autre et de l’influence du son sur un espace géographique local. Cela provoque par ailleurs l’apparition de formes et de pensées particulières et ouvre à l’exploration de la dérive des corps dans un territoire soumis à des phénomènes de mouvements issus de différentes logiques et approches artistiques tant sur le plan de la perception, des supports, de la durée. Les deux artistes - dans ce travail « à deux identifié comme tel et ayant une existence indépendante de chacun d’eux » - ont donc « composé » à tous les sens du terme avec le phénomène des « ondes stationnaires » prises comme relation physique entre le son et l’espace. Le livre en décrit le processus, le DVD les mouvements. Cela perturbe diverses formes de lisibilité avec lesquels cependant l’auditeur lecteur entre plus qu’en symbiose : en empathie. Il suffit pour cela d’utiliser le regard et l’écoute avec sensibilité et avec une énorme dose de "présence" (au sens du temps présent). Toute une vie existentielle (mais pas au sens sommaire du terme) se mélange étroitement à une vie esthétique. De même qu’une sorte de spiritualité (la musique étant selon Schopenhauer le plus abstrait des arts) est liée à un chemin physique entretenue par le travail sur les ondes et sur leurs voies de paix comme La Casa pour sa part l’a déjà fait sentir dans plusieurs de ses travaux. Sa stratégie est de fait renforcée par Guionnet qui forme son approche à plus d'organisation. Toute la puissance des sens est ainsi convoquée. Elle séduit par ses contrastes qui conduisent les deux musiciens à abandonner les conventions de la musique et même du son.. « Aucun moule ne doit venir s’appliquer sur l’espace sonore » dit La Casa. Et seule l’épreuve du quotidien la découverte de sa « trivialité positive » (Baudelaire) ouvre à une abstraction (encore) inédite que les artistes comme des moines laïques tentent de saisir par leurs approches qui selon eux se caractérise moins en terme de résultat que d’hypothèse. Cela renforce la puissance du son et de l’espace à l’épreuve du réel : le plein existe par la présence du vide. Et même le mot substrat soudain parle fort aux deux artistes sensibles à la matière, de toutes les manières qui soient. Ce qui reste passionnant dans ce travail tient à ne pas savoir ce que les artistes eux-mêmes vont atteindre effectivement puisque chaque étape offre de nouvelles prises de conscience, de nouvelles ouvertures/portes. Elles nécessitent elle-même la mise en place de nouvelles hypothèses... En aïkido on dit que seul compte le chemin, et non le but et c’est ce qui se passe dans cette recherche bipolaire. Au fond de leur travail La Casa et Guionnet, essaient d'offrir par le biais de leurs investigations sonores et visuelles un pont pour que la personne qui regarde et entende puisse accéder à la beauté d'elle-même via l'univers. Dans les sculptures sonores par les ondes l'opaque se creuse. Elles nous forcent à divaguer au sein même de l’espace et de son cerclage. La profondeur de l’oeuvre naît de son caractère expérimental dans l’utilisation (entre autres) de document iconique : la succession des images urbaines crée avec la relation au son qui les distancie dans leur succession une sorte de « documentation de la documentation ». Alors que des photographies, des films de lettres, de syllabes défilent sur un diaporama. Celui-ci a moins le rôle d’indice que d’une autre marche erratique, une sorte de pavé visuel dans la mare des sons sans pour autant être perçu comme un parasitage factice bien au contraire..
La Casa et Guionnet laissent des interstices béants mais afin que dans une sorte de liquide amniotique des formes en gestation prennent corps et trouvent toute leur puissance. On sent à travers une telle « langue » le corps qui parle. Le feu se mêle à l'eau. Se voient par transparence les ombres de l'infini silence. S’éprouvent dans l'épaisseur les émois de la vie. Le trait sonore parcourt la gamme des couleurs. « Reflected waves » est donc un état de recherche et de transsubstantiation prélude à un l'entretien infini des œuvres des deux artistes qui ne cessent chacun de leur côté d’esquisser des remontées essentielles. Paradoxalement et même si leur esthétique n’a rien de réaliste ils vont donc au coeur des choses, au cœur de la ville qui change désormais plus vite que celui des mortels. « Reflected Waves » en est donc une voie d’exploration en demeurant toujours sous l’état de work in progress. Le mot "contempler" peut alors convenir à ce projet. Cela veut signifier que la personne qui regarde et écoute peut prendre le temps avec richesse, angoisse et délice de se contempler elle-même à travers ce qu’il perçoit. Aimant mélanger, reformuler, bousculer, chercher ce qui parle, tout au fond du réel les deux artistes font que l’infini d’une certaine manière prend place dans leurs « Reflected Waves ». Il est autant dans l’installation que dans la personne qui regarde/écoute . Il faut l’imaginer elle-même comme un univers infini. On pourrait presque parler de mosaïques troublantes pour cette œuvre qui affirme une double transparence : celle du son à l’espace, de l’espace à l’être.
Les deux musiciens trouvent un équilibre entre l'ellipse - tournée vers la restriction des formes - et l'énoncé complexe - tourné vers le milieu où ces formes baignent. Reste la nécessité du secret et l'impératif du son entre le corps de l’image urbaine et celui de la musique qui donne des ailes aux images et montre un ailleurs dans l’ici-même.
JPGP
|