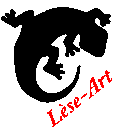I
| L'IMAGE ET SA POUSSIERE : LE ROI FLOU |
| Crystèle Lerisse, Editions Trans Photographic Press, Paris. |
Est-ce parce que l'individu s'accommode mal du monde que l'image dans certaines œuvres d’art contemporain se floute ? S'agit-il alors d'un phénomène de myopie ou de brouillage ? La seconde solution semble plus conforme à toute une esthétique du temps. Cela n'est pas neuf. Avec "Delocazione" (1970) ou "Autoritatto" (1977) Parmiggiani avait déjà choisi le flou qui devint pour lui un "monstre dialectique". Ne demeurait sur une toile photographique que des formes en esquisse ou en disparition. Tout un jeu d'ombres se mit à dépasser la science des contours.
Ce parti pris se retrouve aujourd'hui chez des artistes aussi différents que la photographe Chrystèle Lerisse, Marc Formes, Pipilotti Rist ou Yang Qiang. Les diverses séries dont "Urbanus - photographies" le prouvent chez la première. On la retrouve chez Marc Fornes avec son installation "N/Edge". L'architecte et fondateur du studio de design "TheVeryMany" produit une série de floutages en trois dimensions. Ce processus est évident dans bon nombre de vidéos abstraites, figuratives ou oniriques de Pipilotti Rist en particulier avec « I’m not the girl who misses much ».
Chez Lerisse ou Fornes comme chez les vidéastes émerge une rêverie architecturale. Leurs travaux font passer d’un univers surchargé d’images à celui d’un effacement. Ils donnent l’impression que le temps se défait. On ne peut pas ne pas penser à Beckett - lui-même spécialiste du floutage dans ses œuvres télévisuelles et en particulier dans « Nacht und Traume » - et à sa phrase "vivre est errer seul vivant au fond d'un instant sans borne". Ne restent que des "indices" d'un monde. Celui-ci devient le sujet dépouillé des œuvres, leurs marges d'un presque obscur. On voit mal pour voir mieux là où la substance, le concret s'indéterminent. Perdurent des zones, des seuils et quelques gradients le plus souvent minéraux. Mais une puissante vitalité les soulève. L'image est démontée puis remontée par des pans ou des lignes "floutées" qui brouillent les pistes.
Le flou porte à voir le fantôme des choses ou des êtres. Le procédé remonte à l'origine du cinéma. Cependant il ne faut plus voir désormais dans le brouillage qu'une puissance d'indifférenciation - sans quoi ce processus resterai plutôt vain. Existe chez Parmiggiani ou dans les films de la télévision pour de Beckett hier, chez une Lerisse ou les frères Quay aujourd'hui une prise de possession et une ouverture de possibles plus qu'un obscurcissement et une fermeture. Bref de tels artistes montrent mal pour voir mieux.
Le flou devient la capacité à ce qui est mal vu de devenir lieu ou zone du vivant où tout se délite et verse dans l'improbable champ d'une sombre énergie. Quelque chose surgit entre l'être et le non être, la chose et la non chose. Cet entre devient l'identité et la nature de l'œuvre d'art. Quelque chose flotte qui nous aborde, absorbe et nous pulvérise. Le flou conduit vers une autre scène où l’atrophie demeure indissociable de l’énergie susceptible de s’y manifester. Demeurent un nécessaire écart et le sentiment d’un espace ouvert. Il est autant du dedans que du dehors. Il oriente vers on ne sait quel abîme et vers quelle faille sinon :
« ce désir de la vie malgré tout
qui insiste on la sent elle est là
même sous les paupières on la voit » (Jacques Ancet).
A côté de l’espace distinct surgit « l’inséparable indistinct » dont parlait Deleuze dans « Le Pli ». Aux lignes de forces font place des harmoniques aux forces de dérivation qui ne sont pas autres choses que des forces primitives. Le monde n’est plus pris sous ses amas, il devient élastique et se refuse à la (re)constitution. Hors amas les êtres comme les choses sortent de leur statut et se mettent à flotter, à errer. Il n’existe plus d’actualisation, de réalisation du monde mais son nécessaire écart. Reste l’apparition du singulier là où l’effacement pourtant semble régner en maître face au « simul-acre ». Chrystèle Lerisse en reste actuellement la représentante la plus impertinente. Chaque corps, chaque objet entrent dans une zone d’étrangement à la fois intermédiaire et originale, hors possession, hors accès public. A l’épaisseur fait place le voile, à la détermination, l’indétermination hors charnière, hors couture. Preuve qu’on ne réalise pas le corps ou le monde, il est réalisé. Liebniz et son « esse est percipi » n’est pas loin.
Le « sans-forme » n’est pas l’informe. C’est la plénitude ouverte et sans confins avant que les formes soient et pour qu’elles se fixent. L’ouverture épuise ainsi l’inexprimable avant. Le « sans forme » de Crystèle Lerisse n’est donc pas non plus la forme mais son instance ouverte : forme sans forme, matrice et attente dans cet excès qui n’est pas l’ordre du nombre mais une sorte de retrait dans l’absolue distance au moment où pourtant quelque chose prend forme contre le néant et le hante. Se produit ainsi la première surprise de la beauté comparable à celle dont parlait Baudelaire à propos des « merveilleux nuages » que seuls les enfants qui s’ennuient savent regarder.
Au marge du monde s’ouvre une béance mais c’est aussi l’antre où se fomente une présence. L’oeuvre de Lerisse n’est pas encore le monde, ne le sera jamais mais elle offre son rebord en une substance quasi impalpable. Une telle recherche rend le néant plus proche et plus lointain à la fois. Car voici le paradoxe : le visible semble se dissoudre dans le néant qu’il dissout. Il existe une étrange incandescence froide que ne trouble aucun bruit. Ce qui nous hante sourdement d’une certaine manière s’efface. Cette rencontre est désirable pour certains. Nécessaire pour tous. |

|
![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue- 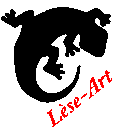
![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue-