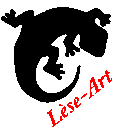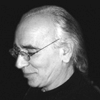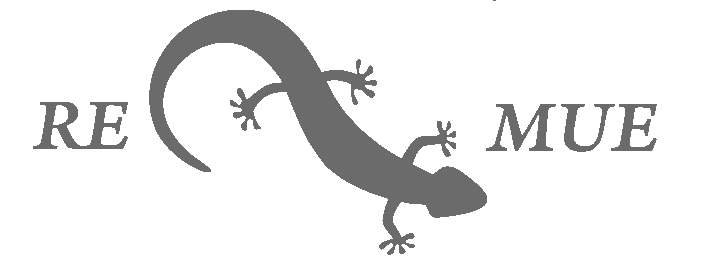Editorial : Jean-Paul Gavard-Perret
PÂLES HAIES DES VILLES |
|
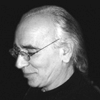 |
PÂLES HAIES DES VILLES
Lieu de passage, sans charme mais attractif grâce au système de signes qui s'y déploie, la périphérie de nos cités post-modernes est devenue l'univers de l'architecture de la persuasion et du racolage. Dans une interview à propos de son premier film - "Stranger than Paradise" - Jim Jarmusch avait déjà levé le lièvre : "La périphérie des centres commerciaux dans leur architecture de la misère ornementale est une pute" . Qu'y voit-on en effet sinon des boîtes à armatures métalliques sur lesquelles on colle des signes de reconnaissance? Par compensation, ce qui est refoulé à l'intérieur est exhaussé dans l'effigie. Lieu commun minimaliste, la périphérie de nos villes regorge ainsi d'une troublante curiosité. Elle est devenue le lieu fourre-tout, trouve-tout, l'immense braderie permanente dont les anciens marchés aux puces des faubourgs n'étaient qu'une archéologie que la périphérie - du moins ceux qui l'on prise en otage - a élevé à un stade exponentiel.
L'immense conglomérat de New-York nous l'a appris dès les années quarante du siècle passé : la banlieue est devenue le territoire interlope du vide et du trop-plein. Elle représente un espace insignifiant, sans identité ni qualité : toutes les banlieues se ressemblent désormais sous le sceau des enseignes qui en composent les espaces commerciaux (Darty, Kiabi, Carrefour, Intersport, Intermarché, etc.). Sa banalité est donc désormais doublement habitée : d'une part par ceux qui y vivent - mais qui sont relégués loin des axes visibles de pénétration-, d'autre part par ceux qui ne font qu'y passer pour satisfaire sinon leur curiosité du moins leur faim. Bref la périphérie est traversée par une double expérience humaine à laquelle il faut désormais ajouter une troisième encore plus invisible que la première citée : celles des "réserves", des villages-bunkers qui fleurissent aux Usa, mais qu'on trouve déjà dans les banlieues des villes européennes, et où s'enferment une bourgeoisie vieillissante et nantie. Néanmoins, camouflée au regard - d'une certaine manière elle n'appartient pas au paysage qu'elle confisque à son agrément.
La société de consommation s'est donc appropriée la partie visible de la périphérie : celle que jouxte les divers axes d'échange et de pénétration. Cette société, la nôtre, jamais avare de gâchis et de destruction n'a cesse d'y construire ses temples, de leur frayer un nouveau "décor" avec le prétexte de nous rendre la vie plus facile. Il suffit d'un petit espace vierge pour qu'elle vienne le remplir et, par voie de conséquence, restreindre notre horizon à travers sa laideur affichée et ce, paradoxalement, afin de nous séduire, de nous offrir sa fête et ses paradis artificiels. Ce qui nous revient se résume alors à l'architecture aussi baroque qu'austère du rien et du trop-plein. Bref un amalgame à la fois cohérent et hétéroclite que nous ont permis de voir ou d'anticiper, du côté du roman et du film américains, les Lynch, De Lillo, Roth ou Pynchon.
En marge de la ville et la vidant pour une part de son centre, surgissent de plus en plus des "Malls" (au mieux) et le plus souvent de simples hangars bariolés de couleurs distinctives. Ils servent de lieux de vente commodes d'accès et pratiques puisque largement entourés des plages de bitume-parking qui isolent chaque bloc l'un de l'autre. L'anatomie de tels lieux (communs mais pas forcément communautaires même si s'y brassent divers population) permet de lever le voile sur la fabrique du quotidien et son "décor". Aux confins de la route et des lieux de résidence, les centres commerciaux (dont l'agencement d'ensemble fait ressembler la banlieue à des villes western) offrent à la fois confort et inquiétude, protection et "aventure rêvée" à portée de mains puisque moyennant finance tout est possible. Et plus qu'un autre, Philip Roth - de la série des Portnoy au "Rêve américain" - a donné le sens de ce nouveau paysage post-urbain. Newark, sa ville natale, est d'ailleurs le parangon d'une ville déjà excentrée et rejetée aux lisières d'un centre incarné par New-York. Mais Newark a créé aussi une périphérie de la périphérie. L'auteur a montré combien cette dernière rapproche et éloigne, fascine et révulse. La force du romancier est en effet de souligner la distribution des plaques tectoniques d'un tel lieu. Sans formalisme - afin de mieux souligner l'a-morphisme de ce paysage in absentia - mais avec une force spéculaire il a démonté plusieurs fois la topologie d'un espace qui dénature le paysage pour en faire un territoire à la fois no man's land et bondé.
Il a illustré aussi combien un tel paysage-frontière est devenu le modèle même d'une sorte d'exhibition capitaliste. Alors que dans le tiers-monde la ville tentaculaire essaime sous forme de quartiers interlopes, la ville post-industrielle à vocation mondialisante fait des centres commerciaux périphériques un cas d'école porteur de signes distinctifs de richesse et de pléthore. Ce type d'envahissement commence d'ailleurs à se répandre en dehors du monde occidental : on en trouve par exemple au Maroc sous forme embryonnaire dans les périphéries de Casablanca ou de Rabat. A ce titre l'art dit déceptif et à la mode du temps possède de quoi se satisfaire de tels infrastructures "architecturales"- on ose à peine le mot tant on ne peut parler au mieux que d'aménagement. Ces constructions sommaires répondent à d'autres préoccupations qu'à un souci de bien-être ou de qualité de vie. Le seul objectif demeure le moindre coût au nom d'une rentabilité qui dicte les impératifs du nouveau paysage périphérique. Les "transformateurs commerciaux" sont donc bien loin des "transformateurs Duchamp" . Ils ne fabriquent que des structures dépendantes de l'époque en dupliquant des recettes d'efficacité commerciale et se soucient peu d'une économie du paysage. L'esthétique - du moins ce qu'il en reste - ne répond à aucune une "éthiquette" si ce n'est commerciale. Le mot a d'ailleurs vite perdu son h pour devenir une simple marque de reconnaissance. Mais une étiquette ne fait pas une éthique ni mille enseignes une parole, ni cent drapeaux publicitaires une cause qui nous habite.
Cependant, pour les investisseurs de la grande distribution, ce qui compte est d'ouvrir en de tels lieux - en dehors de toute réflexion sur le paysage - une scénarisation hâtive et sommaire en vue d'un enrichissement maximum. Comme l'écrit Christian Parisot, ici "les codes sont imposées par le capital". Et les architectes et paysagistes qui les créent n'échappent pas au pouvoir économique ; ils y répondent au contraire, le devancent et lui accordent son code de reconnaissance et d'accréditation. Le capital, à travers les zones périphériques commerciales, est donc devenu le modèle mondialisant simple et sophistiqué à la fois et Parisot va jusqu'à considérer ces lieux comme "rien d'autre que la carte d'identité du capital". Du paysage il n'est alors plus question. On le biffe, on le raye, on fait une croix dessus - celle de la Javel du même nom par exemple. Car les nouveaux marchands du Temple connaissent parfaitement les attentes et les besoins de consommation. Et les architectes et paysagistes se sont réduits à ne devenir que les serviteurs zélés sinon de leur temps du moins de ceux qui le régissent. Leurs boîtes entourées de bitume constituent des labels, des griffes, cela (leur) suffit. Et les zones qui ne possèdent pas de tels "emblèmes" deviennent des pestiférées et des indicatrices (en creux) d'une région en désuétude.
Que reste-t-il pourtant au consommateur sinon un plaisir mal consumé et mal accepté, un désir contourné de jouir qu'il va tenter de venir éponger, assouvir en des lieux de regroupements où ne demeure qu’un vertige angoissant puisqu’au sein de telles zones aucune quête du changement n'est proposée ? La délivrance est absente, le déplacement proposé n'est qu'un départ raté, une attente exaspérée dictée par la seule envie d'une "distinction" sociale à travers l'achat de la marchandise. A ce titre les centres commerciaux périphériques ne créent rien de neuf. Mais il y a pire, car ils ne font pas que déplacer la ville vers l'extérieur. Certes, le consommateur est désormais privé de ville : il ne lui revient qu'un lieu interlope, pratique peut-être mais surtout laid. Et c’est pourquoi franchir le seuil de la ville n’est pas seulement un leurre, c'est, par la laideur honteuse des lieux proposés, un affalement encore plus flagrant dans l’orthodoxe de la consommation en dehors de toute autre perspective.
Non seulement le décor a changé mais il a disparu. Il n’existe pas de place à une réelle jouissance du paysage. Au contraire. L'être est livré à une laideur accrue dans le mépris de tout sens esthétique. Le saut du centre vers la périphérie n'est donc pas qu’un bond sur place voué à embrayer les mêmes répétitions, à ne permettre que de retomber dans des structures à l'identique afin d'en préserver l’invariance. Au gain supposé de temps et de bénéfices contestables fait rempart un enlaidissement accru de ce qui est donné à voir. Tout se passe comme si le paysage était supprimé, dévalorisé, rendu lettre morte. Et le nouvel espace de la consommation étire son vide à l’infini, un vide sans doute disponible, rassurant puisqu’il est le même partout. Cependant tout semble se passer comme si devant et derrière la frontière entre la ville et sa périphérie ne reste que du pareil, du même - mais, esthétiquement, en pire. Comme l’écrit Julia Kristeva, « Passer devient alors un acte nul ». C’est d'ailleurs une forme ordinaire de pseudo-préservation du capitalisme que d’effacer la ligne de passage, le seuil.
Le seul moyen qu'ont alors trouvé les concepteurs de telles boîtes pour nous donner le change est comme l'écrit Roth de "mettre le Mont Fuji sur des éventails". En émondant la notion même de paysage aux profit de leurs intérêts les vendeurs d'ersatz réduisent l'être à portion congrue, à son minimum vital. S'approcher du seuil de tels espaces ce n'est donc plus espérer voir un autre horizon. D'une certaine manière en ces aires seule la carte bleue est valable. N'est plus possible, en dépit des néons, l'apparition des "phosphorescences mystérieuses où sur les ruines du réel se redessine une architecture admirable nourrie de la clarté des paysages" dont parle Bonnefoy. En croyant lutter contre le vide on retombe en un autre vide car l'architecte, du moins ce qu'il en reste, n'est plus un bâtisseur mais un réducteur de rêve : il spécule sur l'espace qu'en croyant construire il anéantit et dans lequel celui qui pénètre rentre en un désert qu'il ne finit plus de franchir. Désert bien sûr plus sulpicien que géophysique : en son labyrinthe y circulent nos semblables, nos soeurs, nos frères - animaux des plus bizarres. Dans leur périple à l'identique la recherche existentielle est remplacée par du bonheur sous code-barre.
A chaque zone commerciale se répète ainsi la question d’un enlisement et d'une défaite : l'être contraint et forcé y patauge et suit un rituel incantatoire pour croire combler un vide. Réduit à ne rester qu'unidimensionnellement consommateur , il n’a cesse de tourner en rond, en un lieu où le regard butte sur ce qui ne mérite même plus le nom de paysage. D'une certaine manière la boucle est bouclée en un fantastique système de récupération. Dans son éloge implicite de la bordure devenu paradis de la consommation, le système n'a donc qu'un but : classer, ranger et détruire le paysage. Ce qui est donné à voir n'est plus de cet ordre : il s'agit d'une sorte de stuc grossier et agressif où s'inscrivent en lettres de feu et en couleurs criardes le nom de ceux qui entravent et salissent ce qu'ils osent appeler un cadre de vie dans leur publicité. Si cadre il y a, dedans - au sein de la pléthore qui nous envahit contre la beauté possible du monde - il n'y a plus rien - du moins de notre vie. En absence d'horizon elle ressemble à un vide.
Jean-Paul Gavard-Perret.
|
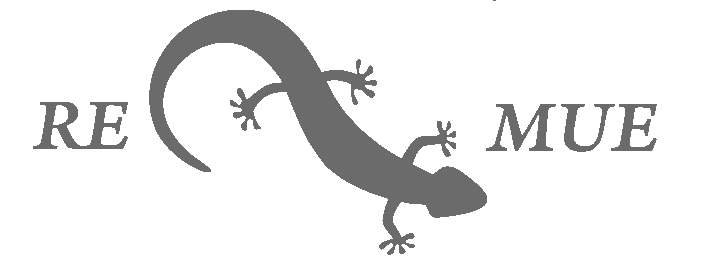 |
|
![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue-